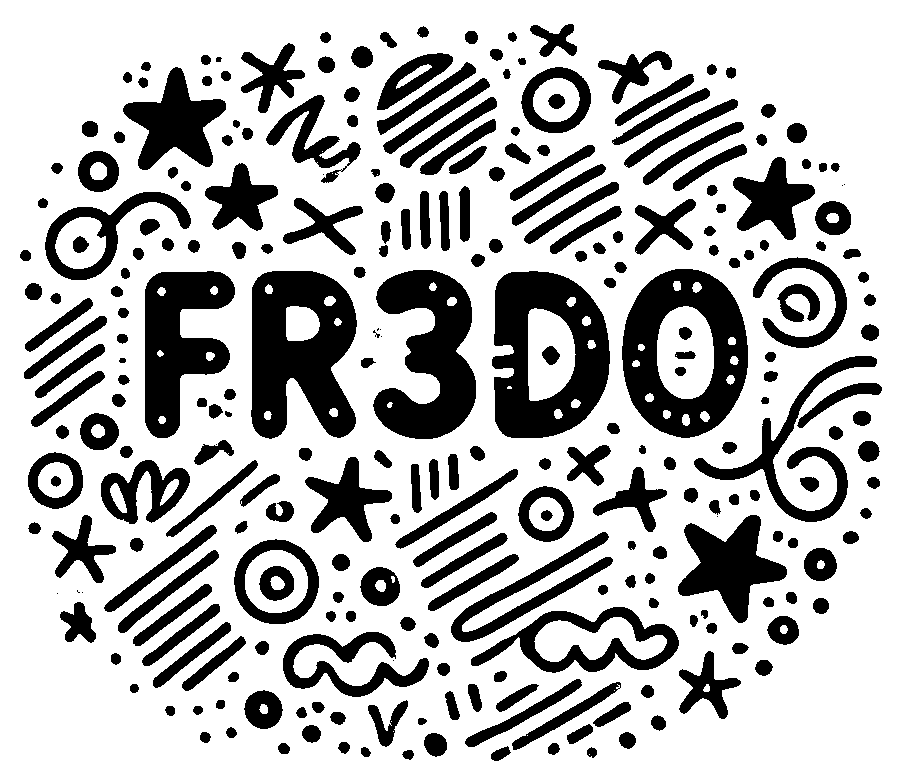J’ai toujours la même pensée quand je sors de ma voiture à 6h moins 10, je pense à cette traqueuse obsessionnelle à l’obession contagieuse. J’en suis sa proie et elle me le rappelle précisément à ce moment là tous les matins. C’est comme un piège ; c’est un lieu qu’elle semble s’être approprié. Elle ne cherche pourtant pas à m’attaquer. C’est plutôt un jeu ; un jeu sadique. Je l’a vois m’observer tout autour de moi alors que je me déplace entre les immeubles. Tout est silencieux. Tout est froid. Tout est pénombre. Le bitume, le béton, les néons, l’activité humaine s’est exprimée partout ; elle témoigne du mouvement expansionniste de la vie, de notre vie. Pourtant c’est cette traqueuse qui occupe les lieux. Bien qu’étrangère à notre monde, elle s’incarne remarquablement bien dans nos conceptions.
Elle est habile. Son guidage se fait sans pression, sans sensation consciente, sans se faire remarquer. Une pierre qui roulerait sur une pente penserait qu’elle avance par elle-même sans même comprendre qu’elle a été le jouet d’un mouvement qui la précède, qu’il soit géologique, animal, ou un acte humain. Les chasseurs font de même avec les animaux et les guident dans leur piège en jouant des règles instinctives de ces pauvres bêtes qui se pensent toutes aussi libres que nous. Inconsciemment, ignorant que c’est cette traqueuse qui décide pour moi, je me laisse entrainer aussi impuissamment qu’un animal dans son piège, un piège sadique. Bien qu’elle ne souhaite pas encore me faucher, elle joue de mes sentiments et me rappelle sa présence dans ce parking ; elle accompagne mon mouvement, mon déplacement en faisant le tour des immeubles ; et dans un entre deux, le ciel apparaît dans toute sa hauteur ; c’est alors qu’elle contraint mon regard à se fixer sur mon destin en voyant le ciel : noir, inexistant. Je voyais encore les étoiles il y a une heure en sortant de chez moi. Ont-elles déjà fini leur cycle de dilatation-combustion pour s’éteindre dans l’univers froid et infini ? La réalité importe peu, c’est la vérité qui me fait face au-delà des temps. Mais je suis pareil à elles. Je m’éteindrais dans le néant.
D’habitude la lumière fait disparaître ces angoisses vertigineuses. Mais ce lieu est possédé par le pouvoir de la traqueuse. À chaque fois que je traverse ce parking, le monde s’affadis, les goûts, saveurs, senteurs et joie se nihilisent. Tout aussi insidieusement qu’elle dicte mes pas, elle se permet d’aposer sur mon visage une paire de yeux, parmis les milliers, dit-on, dont l’ange Azrael est pourvus. Elle me dévoile alors volontairement un lieu dépourvus de sens humain. Les murs et le sol sont mis à nus, dur et rugueux, l’air est froid et sans sentiment, la lumière demeure une mécanique dépourvus d’empathie. Tout ça stationnant, attendant sa propre érosion ou sa destruction par une catastrophe naturelle ou cosmique. Une œuvre délaissée qui se meurt tout autant que ces monstres de feu que tous les peuples planétaires ont loué à travers les siècles, conscients du bienfait de la vie qu’ils transmettaient sur nos cailloux flottant, exerçant un mouvement circulaire et révolutionnaire sans fin. Ces monstres – gentils monstres – desquels à l’instant je contemplais l’absence. À qui manqueraient-ils si ce n’est à ceux qui ne sont déjà plus là ? Dans l’échelle de l’évolution, nous constituons une fabuleuse anomalie, notre intelligence mentale et notre capacité de représentation complexe, sans compter les vertus de nos membres – faibles mais agiles – ont transformé l’humain en la bête dominatrice de la planète, exécutant la Nature selon ses propres plans. Nous sommes une anomalie, un incident. Notre singularité a fait de nous des êtres qui déployons nos représentations par des actes et conceptions matériels que nous imprégnons de significations. Nous pouvons remettre en cause beaucoup des actes humains, mais en contemplant le ciel, nous nous rappelons que si nous sommes le fruit d’une conception accidentelle de la nature ayant la capacité de la renverser, il y a eu un incident il y a 13 milliards d’années qui a généré ce fourbis, cette voute et ce qu’il y a ici et dessous. Un fourbis, à qui et pourquoi ? Nous pouvons remettre en cause l’impact de nos agissements sur la nature, mais notre industrie n’a pas de sens pour les animaux qui s’attribuent ou se font une place, un nid, une toile, un terrain de chasse et qui prolifèrent en l’absence humaine au sein même de ce que sa société a batis. Ces constructions n’ont pourtant pas été faites pour ces bêtes, mais elles l’investissent pour y puiser ce qu’elles peuvent à leur mode de vie. Notre rapport à l’univers ne peut être différent à celui des animaux pour nos œuvres. À qui diable est destiné l’univers ? Dans quel but et pour quelle signification ?
Je passe la porte extérieur, puis la porte du sas avant d’entrer dans la cage d’escalier. Si ce n’est une aération ou une machinerie inconnue, c’est silencieux. Je monte les marches avec une sensation d’oppression, d’étouffement psychologique. Une angoisse grimpe dans ma tête. J’ai déjà vécu ça. En fait je l’ai vécu des dizaines de fois. Il y a quelque chose d’affreux que je n’arrive pas à cerner. Cette cage d’escalier est comme un cercueil, ces murs beiges et sans personnalités emprisonnent les cris d’agonisant-e-s.. Je reviens au plus lointain que ma conscience puisse identifier cette sensation ; déjà à l’école primaire, c’était des jours pluvieux – non d’ailleurs ! Pas simplement pluvieux ! Ce n’était pas une simple pluit. Le vent battait fort, il y avait une averse ; loin des pluits innoncentes, c’était une menace du ciel, des grêlons peut-être. Le ciel s’abattait sur la récré et dans les rues ; pas un sensé n’oserait marcher tranquillement sur les trottoirs dans ces moments là. Je me souviens de la monté dans cette cage d’escalier de l’école primaire, lorsque la récréation était terminée. J’étais habité par cette même inquiétude, cette montée d’angoisse. Nous étions pourtant au milieu de la journée, mais qu’il faisait sombre ! Et tous ces enfants autour de moi, montant en même temps, ils font du bruit, ils poussent un peu. Qu’y avait-il de singulièrement préoccupant ? Ces fois là rien. Je revivais simplement une angoisse comme je le fais aujourd’hui – un traumatisme originel encore antérieur et inconnu – en montant les marches de la cage d’escalier. J’en ressortirai dès le premier étage et après avoir passé mon badge de sécurité dans le couloir je retrouverai des vivants en besogne.
Il y a toute l’artificialité de cette cage, son aspect pleinement et uniquement fonctionnel, froid. Il y a ce bref moment d’enfermement dans ces murs épais, ces portes lourdes, coupe-feu ; c’est un abri, une sorte de bunker comparé au reste de la structure du batiment. Un refuge pour la fuite ou la sauvegarde. Quand j’étais petit et que je jouais avec mes LEGO, j’avais construit une sorte de miniature, un vaisseau spatiale que mon imagination concevait comme bien plus grand que ce que l’espèce humaine a pu construire comme batiment sur terre. Peut-être en étage n’était-il pas le plus grand, en revanche, ce n’était pas un vaisseau tour et sa surface était gigantesque. C’était la technologie, le moyen de transport, le plus élaboré, le dernier refuge, la dernier vaisseau, l’arche de Noë, d’une espèce intelligente (qui n’était dans mes jeux d’ailleurs pas humaine puisque j’avais remplacé les têtes – perdues par mégardes – par des briques). Tout comme ces paquebots qui sont construits de nos jours – paquebots de luxe offrant des croisières avec des prestations dont je n’aurais jamais les moyens de m’offrir – mon vaisseau spatiale était une véritable ville avec tous les lieux nécessaires à la fournitures des besoins, des activités, du divertissement, de la relaxation, de la culture… J’y imaginais un immense jardin ou parc dans l’enceinte même du vaisseau, un étage à part qui ne donnais pas vu sur l’espace, mais plafonné, illuminé par des lumières qui facilitaient la photosynthèse des végétations qui restaient quoiqu’il en soit des êtres biologiques naturelles – et non une représentation mimée ou falsifiée ne nécessitant pas d’entretien… si ce n’est la poussière. J’avais un peu l’idée du jardin intérieur des parents de Bulma dans le manga Dragon Ball, qui laissait libre dans cet espace, de nombreux animaux ; même des dinosaures ! Il y aurait aussi un hôpital avec ces différents services, un lieu de représentation théâtrale, de spectacle. Plusieurs pièces ? Je l’ignore. Je n’ai jamais réfléchis sur le nombre de personnes qui seraient en voyage dans ce vaisseau. Il y aurait aussi des salles de sports. La restauration serait uniquement collective. Peut-être avec un choix au menu, ou peut-être plusieurs restaurant ayant leurs propres spécialités ; encore une fois, sans une idée du nombre… Tout comme dans un paquebot, les voyageurs ne disposeraient que d’un lieu privée, un espace réduit à une chambre, avec salle de bain/toilette. Point. A disposition une commode avec des vêtements possédés par chacun-e, un matériel électronique individuel, un écran. Le reste c’est collectif. Si le parc-jardin n’avait aucune vue sur l’espace, j’imaginais les appartements privés comme ayant toujours une baie vitrée donnant pleine vue à l’extérieur. Pour moi ce ne pouvait être que désirable de voir l’univers et ses étoiles par la fenêtre. Pourquoi les cacher dans un espace bunkerisé ? D’ailleurs sur les bords extérieurs du vaisseau, ce serait beaucoup de long couloir que j’imaginais de couleur chaude – sol rouge et mur jaune (je n’y connais rien déco) – où se promener – comme les ponts d’un navire – et admirer l’univers à travers une longue baies vitrée s’étalant sur la longueur, tout comme on pourrait contempler la mer. Ce vaisseau n’était pourtant en rien un vaisseau de croisière. C’était un vaisseau de mission, ou – comme l’arche de Noë – de (sur)vie pour une espèce quittant sa planète. Les personnes ne sont pas là pour se tourner les pouces. Les enfants ont une école – collège – lycée – université, pour l’apprentissage. Et chaque adulte a une profession. Chacun et chacune travaille dans le vaisseau (l’hôpital a besoin de personnel soignant, les restaurants de cuisinier-e-s, etc.) Il existe une politique de natalité, de contrôle des naissances, afin de respecter un équilibre, dans le nombre d’individu (éviter un trop plein de naissance qui rendrait les ressources insuffisantes ou au contraire les motiver – y compris par la procréation artificielle). Un laboratoire embarquerait entre autre des tas d’échantillons de matériel génétique dans le but d’effectuer des générations – de plante ou d’animaux pour modifier la faune et la flore du parc – mais aussi humaine ; dans un voyage de temps indéterminé (et peut-être sans but désigné) impliquant des générations d’êtres humains, la diversité génétique en espace reclus peut finir par faire défaut et il serait donc nécessaire d’en réinjecter régulièrement. J’ai inventé une forme de communisme avant l’âge d’avoir une conscience politique. L’organisation de la vie et des besoins est au au maximum collective tout en respectant une intimité via l’attribution d’un espace ou de matériel privé et strictement égalitaire. Il aurait d’ailleurs été possible de croire qu’en l’absence de représentation politique ou de processus décissionnel collectif, j’eu également inventé l’autogestion ; le recul m’apprend qu’il n’en était rien et qu’il s’agissait plutôt d’une curieuse dictature mené par un commandant ou un conseil semi-militaire d’individus restreints, nullement élus et non-tournant. Si les activités de cette ville dans l’espace sont effectivement réduite à des aspects administratifs et fonctionnels, l’activité politique meurt ainsi que l’ont prédis Marx et Engels à travers l’exégèse de Lénine. Par contre, le vaisseau lui, va bien quelque part. Il a un équipage qui le pilote et forcément il y a un choix qui est fait quant à la route dessiné, au parcours à effectuer. Je n’ai jamais conçu que ces choix furent démocratiques. Je ne pouvais pas comprendre comment le processus de décision pouvait être pris. D’autant qu’il s’agissait en premier lieu là encore d’un choix fonctionnel ou opérationnel : la survie, les ressources, c’est très pratique et pragmatique. C’est une personne ou un groupe de personne qui en fonction de l’état des lieux et des nécessités établissent la destination de préférence et les missions qui en découlent pour alimenter la survie du vaisseau et de ses occupant-e-s. Le critère est finalement lié beaucoup à l’intelligence, à la sagesse. Il s’agit d’un pouvoir politique « éclairé ». Mais contrairement à une dictature ou à ce qu’on peut définir comme bureaucratie, cette ou ces personnes ne disposent pas plus de moyen que d’autres et sont tenus aux mêmes limitations égalitaires. Il n’y a pas de gain matériel. Il n’y a qu’une gratification symbolique. Cette arche technologique devait permettre non pas uniquement une survie, mais une vie à toutes celles et tous ceux qui y auraient pris place ; la technologie aurait été développé aux maximums dans l’esprit d’une autosufissance, d’un recyclage maximum de tout ce qui est consommé dans le vaisseau, voire d’une production ex-nihilo – à partir de rien ou presque rien ; un vaisseau qui aurait eu la capacité de faire vivre une population au-delà de la vie et de la mort des étoiles ou des galaxies, possiblement au délà de l’extinction même de l’univers.
J’en suis quand même venu à me demander à ce que j’avais fait à ce peuple imaginaire, condamné dans une ville entourée de néant. À ce moment je me dis que la pire chose c’est d’avoir mis tant de fenêtres pour admirer l’univers. Maintenant elles ne leur serviraient plus qu’à admirer le rien qui entoure leur forteresse lumineuse, chaleureuse qui, de l’extérieur, resterait une lumière à peine visible dans un confin indéterminable de l’univers, une bougie éclairante dans un château en ruine, délabré, meurtris des cadavres pourrissants, offerte inutilement pour des yeux absents à l’admirer ou à s’y accrocher. Est-ce qu’ils ne se sentiraient finalement pas comme moi en ce moment dans cette cage d’escalier, ressentant avant tout le poid, la charge, d’un cercueil de béton, un bunker sauveur qui ne prête aucune tendresse ?