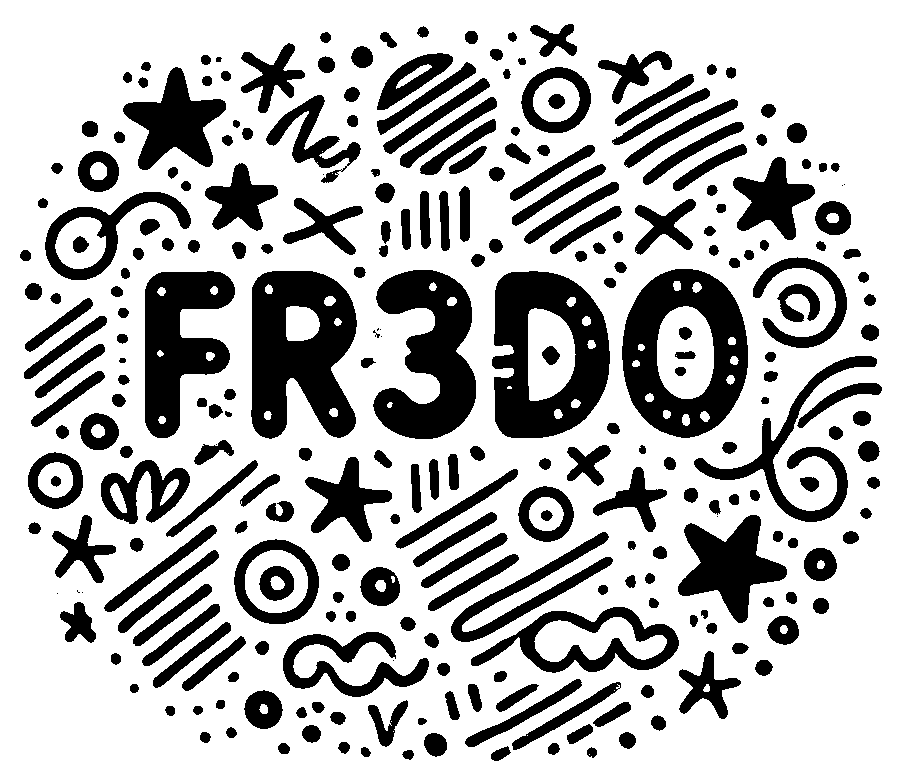C'était le 31 décembre, dernier jour de l'année. Le temps était comme aujourd'hui : très froid. Ce froid faisait frissonner notre corps. Mais le soleil brillait dans le ciel. Un ciel dégagé de tout nuage, bleu clair. Le froid atteignait notre corps, mais la lumière du soleil savait réchauffer notre cœur.
J'avais passé la journée ailleurs, en sortie, voir des camarades. Des camarades un petit peu ami-e-s d'ailleurs. Rien à voir avec l'arrivée de la « nouvelle année » non. C'était pour des choses moins exceptionnelles. Mais qu'importe. J'avais d'autres projets pour fêter ce nouvel an. Je revenais en début de fin de journée chez moi, vers 16h. Je justifie ainsi car à 17h le soleil est déjà bien bas est crépusculaire. Je suis revenu chez moi alors que la lumière de l'astre brillait encore fort. Fort du moins comme il peut le faire en hiver.
Chaque déplacement est pour moi un voyage. Pourquoi n'ai-je que des relations qui habitent à Perpète-les-Oies ou à Pétaouchnok ? Ça me prend facilement plus d'une heure ; une heure et demi si ce n'est 2 quelque fois.
Je revenais chez moi avec le sentiment d'une journée déjà bien remplie. Du moins bien écoulée. Des choses qu'il fallait faire, qui ont été faite. Des moments à partager qui ont été partagés. Du moins dans la limite de mes aptitudes sociales. J'ai un peu tendance à fuir les autres ; sur tout point de vue d'ailleurs : tant de la rencontre physique que de l'échange orale ou de l'écoute sensoriel. J'ai le défaut de rarement savoir ce que je veux : je me sens mal quand je suis entouré car je peine à trouver des repères comportementaux, savoir m'intéresser aux autres et entrer en empathie avec eux. Mais je me sens mal aussi quand je suis seul ; la solitude est l'amie qui offre une anxiété, si ce n'est une angoisse, existentielle et me rappelle toujours l'ineptie de mon existence. Pour une question d'équilibre, je cherche donc à savoir alterner les deux. Tantôt je me pousse à sortir de chez moi à la rencontre d'autres, tantôt je profite de moment de solitude pour m'égarer.
Aujourd'hui finalement, j'avais fait mon pas vers les autres. Et j'étais embêtés de devoir à nouveau repartir. J'étais tout juste descendu du bus que je sentais déjà la douce chaleur de mon habitat me retenir pour la soirée. Oui. Je devais repartir 2h plus tard, peut-être moins, pour aller voir d'autres personnes, d'autres ami-e-s, d'autres proches – davantage dans le cœur que géographiquement – dans une fête où j'aurais une nouvelle fois peine à savoir où me mettre et m'enjouer avec la galerie. Généralement je tergiverse beaucoup et je pense à ce que j'ai à faire qui puisse avoir un peu d'importance, une espèce d'excuse, qui aura l'air légitime, pour ne pas venir. Mais je suis pris entre deux feux : je pourrais aller encore vers d'autres pourquoi pas ? J'avais peur de culpabiliser de ne pas l'avoir fait, tenter. Ça m'arrive souvent.
Je descend ma rue. Je n'habite pas un quartier fourmillant d'activité. Quelques personnes semblent se promener. Le froid de les arrête pas car la lumière du soleil leur donne du courage. Tandis que j'entame la partie pentu que je descends, je croise un « couple » – en réalité un duo – de flics, une femme et un homme. L'homme s'exprime d'une manière forte, un peu bruyante. Il se plaint. Je peux entendre le contenu de la conversation qu'ils sont en train de tenir et je saisie un minimum de l'affaire dont ils discutent. Le policier est frustré de ne pas avoir eu assez d'élément pour coincer un criminel ; un autre homme coupable – d'après le policier – d'avoir tuer quelqu'un. Je continue ma descente tandis qu'eux – en sens inverse – remonte la rue.
Plus bas un autre homme marche et se dirige dans la même direction que moi. Je ne vois que son dos. Il ne doit pas marcher très vite car la distance entre lui et moi ne cesse se rétrécir à mesure que que je me rapproche de ma maison. Soudain, j'entends le policier déjà croisé l'instant d'avant, piquer une colère et venir avec un pistolet qu'il tient comme un objet à montrer (c'est à dire pas dans une position qui permet de s'en servir). Après un instant d'inquiétude et de doute (j'ai cru qu'il en voulait après moi, que j'étais un suspect non appréhendé auparavant) il ne fait que me dépasser en ignorant totalement ma présence (comme quand on conduit et qu'on entend les sirènes de flics derrières nous, les représentations des séries – surtout américaines – peuvent nous faire douter sur le fait que ce soit nous qui avons commis une infraction en conduisant, jusqu'au moment où ils nous dépassent sans faire plus de cas). En fait c'est l'autre homme, un peu plus jeune que le flic, qu'il cherche à interpeller. Il le rattrape à son niveau et lui montre l'arme comme étant celle qui a servis de moyen du meurtre ; et il accuse l'homme d'être le meurtrier et que ceci soit son arme.
Je suis à peine à quelques mètres d'eux sans trop savoir comment réagir, si ce n'est que ce n'est pas mes affaires. Je trouve le policier un peu « cow boy » ; le genre de flic qui fait de ses enquêtes des affaires personnelles et par conséquent se laisse quelque peu débordé par ses passions. L'autre homme ne reconnaît pas la légitimité ou la légalité du comportement du flic vis à vis de lui. Il repousse ses accusations, verbalement, mais aussi d'un geste physique qui bouscule un peu le policier. Et dans ce geste qui servait surtout de dénégation des accusations il tape dans le pistolet que tenait le flic qui tombe alors à quelques mètres de moi. Les deux se jettent alors dessus. Le flic par peur que l'autre s'en serve contre lui, l'autre homme pour se sauvegarder de la folie du flic. Ils attrapent à deux l'arme qu'ils essayent de retirer de la main de l'autre. Leurs bras tendu, la mire orientée vers moi, un frisson me parcours l'échine. Dans leurs folies rien ne me protège de leur combat et des conséquences inconsidérés de leur acte. J'hésite concernant la direction à prendre. Tout ceci se joue en quelques petites secondes. Dans leur combat, l'arme va changer d'orientation et elle n'est face à moi que pour 1 ou 2 secondes au plus. Si je bouge, je risque de moins savoir évaluer sa direction et donc de moins m'en protéger. Je bougerais quand je serai sûr du chemin le plus approprié pour me réfugier chez moi. Chez moi, c'est à 20 ou 30 mètres !
Mais au fond, à ce moment là, je sais très bien comment ma vie est fichu. Je connais ces propensions à attirer tel un aimant certains événements. La fin est écrite.
Un coup de feu part. J'ai même pas su évaluer sur le moment si je devais m'en inquiéter pour m'en protéger ou observer que l'arme déviais légèrement de moi et qu'elle m'a loupé. Je me suis laissé tombé sur le sol, pronostiquant que c'était finalement l'endroit le moins dangereux. Je ne sentais rien de particulier, pas de douleur. Je n'étais pas touché en ce qui me concerne. Le policier maîtrise finalement l'individu. Et c'est au moment de me relever pour reprendre ma route que je me rends compte qu'en vrai je suis touché au coté droit de l'abdomen.
Je ne me suis pas inquiété à ce moment là, ça ne faisait pas mal. J'étais incapable d'évaluer la gravité de ma blessure. Je ne sentais rien, d'autant plus que je pouvais bouger sans trop de difficulté. Ça pourrait cependant être rapidement assez grave ; et j'ignorais exactement les conséquences qu'auraient une telle blessure sur ma vie. Mais ça ne m'empêchait pas de me satisfaire que, pour trancher le dilemme de la soirée de ce soir, j'avais une bonne excuse.